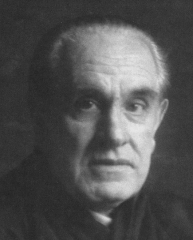 Le domaine politico-social est celui où, par suite de l'action des processus généraux de dissolution, apparaît aujourd'hui d'une façon particulièrement manifeste l'absence de toute structure possédant, du fait de son rattachement à des significations supérieures, la marque d'une véritable légitimité.
Le domaine politico-social est celui où, par suite de l'action des processus généraux de dissolution, apparaît aujourd'hui d'une façon particulièrement manifeste l'absence de toute structure possédant, du fait de son rattachement à des significations supérieures, la marque d'une véritable légitimité.
Étant donné cet état de fait, qu'il faut reconnaître ouvertement, le type d'homme qui nous intéresse ne peut pas ne pas régler son comportement sur des principes totalement différents de ceux qui seraient les siens dans la vie en société si le milieu était autre.
A l'époque actuelle, il n'y a pas d'État qui puisse, de par sa nature, revendiquer un principe quelconque d'autorité vraie et inaliénable. Qui plus est : on ne peut plus parler aujourd'hui d'État au sens propre, traditionnel. Seuls existent, aujourd'hui, des systèmes « représentatifs » et administratifs dont l'élément premier n'est plus l'État compris comme une entité en soi, comme l'incarnation d'une idée et d'un pouvoir supérieur, mais la « société », plus ou moins comprise en termes de « démocratie » : cet arrière-plan demeure même dans les régimes communistes totalitaires ; ainsi s'explique qu'ils tiennent tant à revendiquer la qualification de « démocraties populaires ». Voilà pourquoi, depuis longtemps déjà, il n'existe plus de vrais souverains, de monarques de droit divin, capables de tenir l'épée et le sceptre, symbole d'un idéal humain supérieur. Il y a plus d'un siècle, Donoso Cortès constatait qu'il n'existait plus de rois capables de se proclamer tels autrement que « par la volonté de la nation », et il ajoutait que, lors même qu'il y en aurait eu, ils n'auraient pas été reconnus. Les très rares monarchies qui existent encore sont notoirement des survivances dépourvues de sens et creuses, cependant que la noblesse traditionnelle a perdu son caractère essentiel de classe politique et, avec lui, tout prestige et tout rang existentiel : elle ne provoque plus guère d'intérêt de la part de nos contemporains que lorsque, pour faire un article dans une revue illustrée, on la met sur le même plan que les vedettes de cinéma, les champions sportifs et les princes d'opérette, dans les articles de magazines illustrés, à l'occasion de quelque aventure privée, sentimentale ou scandaleuse de ses derniers représentants.
Mais, même en dehors des cadres traditionnels, il n'existe pas aujourd'hui de vrais chefs. « Aux gouvernants je tournai le dos quand je vis ce qu'ils appelaient gouverner : commencer et pactiser avec la plèbe... De toutes les hypocrisies, la pire me parut être ceux qui commandaient simulassent des vertus d'esclaves » ─ ces mots de Nietzsche s'appliquent encore à toute la « classe dirigeante » d'aujourd'hui, sans exception.
De même qu'a cessé d'exister l'État véritable, l'État hiérarchique et organique, de même il n'existe plus non plus à présent aucun parti ou mouvement auquel on puisse adhérer inconditionnellement et pour lequel on puisse se battre avec une conviction totale parce qu'il se présente comme le défenseur d'une idée supérieure. Malgré la variété des étiquettes, le monde actuel des partis se réduit à un régime de politicards jouant souvent le rôle d'hommes de paille au service d'intérêts financiers, industriels ou syndicaux. Par ailleurs, la situation générale est telle, désormais, qu'alors même qu'il existerait des partis ou des mouvements d'une autre sorte, ils n'auraient presque aucune audience dans les masses déracinés, ces masses ne réagissant positivement qu'en faveur de qui leur promet des avantages matériels et des quêtes « sociales ». Si ce ne sont pas là les seules cordes qui vibrent, l'unique prise que les masses offrent encore aujourd'hui ─ et même aujourd'hui plus que jamais ─ se situe sur le plan des forces passionnelles et sub-intellectuelles, forces qui, par leur nature même, sont dépourvues de toute stabilité. Ce sont sur ces forces que comptent les démagogues, les meneurs de peuple, les manipulateurs de mythes, les fabricants d' « opinion publique ». Il est assez instructif, à cet égard, de voir ce qui s'est passé avec les régimes qui, hier, en Allemagne et en Italie, avaient voulu prendre position contre la démocratie et le marxisme : ce potentiel d'enthousiasme et de foi qui avait alors animé de grandes masses, parfois jusqu'au fanatisme, s'est évanoui au moment critique sans laisser de traces, quand il ne s'est pas reporté sur des mythes nouveaux et opposés qui ont remplacé les précédents par la seule force des choses. C'est ce qu'on doit attendre, en règle générale, de n'importe quel mouvement collectif dépourvu de toute dimension en profondeur, qui s'appuie sur les forces dont nous avons parlé, correspondant au demos pur et à sa souveraineté, c'est-à-dire à la « démocratie » au sens littéral du mot.
Ce plan irrationnel et sub-intellectuel, ou celui de la pure utilité matérielle et « sociale » ─ voilà les seuls domaines qui, après la disparition des anciens régimes, s'offrent à une action politique efficace. C'est pourquoi, quand bien même apparaîtraient aujourd'hui des chefs dignes de ce nom ─ des hommes qui feraient appel à des forces et à des intérêts d'une autre sorte, qui ne promettraient pas d'avantages matériels, mais exigeraient, imposeraient à chacun une sévère discipline, qui ne consentiraient pas à se prostituer et à se dégrader pour s'assurer un pouvoir personnel précaire, éphémère et informe ─ ces chefs n'auraient guère de prise sur la société actuelle. Ce sont les « immortels principes de 89 » et les droits niveleurs accordés par la démocratie absolue à l'individu-atome sans tenir compte d'aucune qualification ni d'aucun rang, l'irruption des masses dans le corps politique, véritable « invasion verticale des barbares par le bas » (W. Rathenau), qui ont mené à cela. Et la conséquence qu'y voit un essayiste, Ortega y Gasset, reste vraie : « Le fait caractéristique de ce temps, c'est que l'âme vulgaire, tout en se reconnaissant pour vulgaire, à l'audace d'affirmer le droit de la vulgarité et l'impose partout. »
Nous avons fait allusion, dans l'Introduction, au petit nombre de ceux qui, aujourd'hui, par tempérament et par vocation, croient encore, malgré tout, à la possibilité d'une action politique rectificatrice. C'est pour guider l'orientation idéologique de ceux-là que nous avons écrit, il y a quelques années, Gli uomini e le rovine. Mais, en raison des expériences que nous avons faites depuis, nous ne pouvons pas ne pas reconnaître ouvertement que les conditions nécessaires pour aboutir à un résultat quelconque, appréciable et concret, dans une lutte de ce genre, font actuellement défaut. D'autre part, comme nous l'avons précisé, nous nous occupons particulièrement, dans ce livre, d'un type d'homme qui, bien que spirituellement apparenté aux éléments dont nous venons de parler, disposés à se battre même sur des positions perdues, a une orientation différente. La seule norme valable que cet homme puisse tirer d'un bilan objectif de la situation, c'est l'absence d'intérêt et le détachement à l'égard de tout ce qui est aujourd'hui « politique ». Son principe sera donc celui que l'antiquité a appelé l' « apoliteia ».
Il importe cependant de souligner que ce principe concerne essentiellement l'attitude intérieur. Dans la situation politique actuelle, dans un climat de démocratie et de « socialisme », les conditions obligatoires du jeu sont telles que l’homme en question ne peut absolument pas y prendre part s’il admet ce que nous avons dit, à savoir qu’il n’y a aujourd’hui aucune idée, aucune cause ni aucun but qui mérite que l’on engage son être véritable, aucune exigence à laquelle on puisse reconnaître le moindre droit moral et le moindre fondement en dehors de ce qui, sur le plan purement empirique et profane, découle d’un simple état de fait. Mais l’ « apoliteia », le détachement, n’entraîne pas nécessairement des conséquences particulières dans le domaine de l’activité pure et simple. Nous avons parlé de l’ascèse consistant à s’appliquer à la réalisation d’une tâche déterminée, par amour de l’action en elle-même et dans un esprit de perfection impersonnelle. En principe, il n’y a pas de raison d’exclure ici le domaine politique et de ne pas l’envisager comme un cas particulier parmi beaucoup d’autres, puisque le genre d’action dont nous venons de parler ne requiert aucune valeur objective d’ordre supérieur, ni aucune impulsion provenant des couches émotives et irrationnelles, de l’être. Mais si l’on peut éventuellement se consacrer de la sorte à une activité politique, il est clair que puisque seuls importent l’action en soi et le caractère entièrement impersonnel de cette action, cette activité politique ne peut offrir, pour qui voudrait s’y livrer, une valeur ni une dignité plus grandes que si l’on se consacrait, dans le même esprit, à des activités tout à fait différentes, à quelque absurde œuvre de colonisation, à des spéculations boursières, à la science, et l’on pourrait même dire – pour rendre l’idée crûment évidente – à la contrebande d’armes ou à la traite des blanches.
Telle qu’elle est conçue ici, l’ « apoliteia » n’impose aucun préalable spécial sur le plan extérieur, n’a pas nécessairement pour corollaire un abstentionnisme pratique. L’homme vraiment détaché n’est ni l’outsider professionnel et polémiste, ni l’ « objecteur de conscience », ni l’anarchiste. Après avoir fait en sorte que la vie, avec ses interactions, n’engage pas son être, il pourra éventuellement faire preuve des qualités du soldat qui, pour agir et accomplir une tâche, n’exige auparavant aucune justification transcendante ni aucune assurance quasi théologique quant à la justice de la cause. Nous pourrions parler dans ce cas d’un engagement volontaire concernant la « personne » et non l’être, engagement en vertu duquel on reste isolé même en s’associant. Nous avons déjà dit que le dépassement positif du nihilisme consiste précisément en ce que le manque de signification ne paralyse pas l’action de la « personne ». Il devient seulement exis-tentiellement impossible d’agir sous l’emprise et l’impulsion d’un quelconque mythe politique ou social actuel, parce que l’on a considéré comme sérieux, significatif ou important ce que représente toute la vie politique actuelle. L’ « apoliteia », c’est l’irrévocable distance intérieure à l’égard de la société moderne et de ses « valeurs », c’est le refus de s’unir à celle-ci par le moindre lien spirituel ou moral. Ceci étant bien établi, les activités qui, chez d’autres, présupposent au contraire l’existence de ces liens, pourront être exercées dans un esprit différent. Il reste en outre la sphère des activités que l’on peut faire servir à une fin supérieure et invisible, comme nous l’avons indiqué par exemple à propos des deux aspects de l’impersonnalité et de ce que l’on peut retenir de certaines formes de l’existence moderne.
Un point particulier mérite d’être précisé : cette attitude de détachement doit être maintenue même à l’égard de la confrontation des deux blocs qui se disputent aujourd’hui l’empire du monde, l’ « Occident » démocratique et capitaliste et l’ « Orient » communiste. Sur le plan spirituel, en effet, cette lutte est dépourvue de toute signification. L’ « Occident » ne représente aucune idée supérieure. Sa civilisation même, basée sur une négation essentielle des valeurs traditionnelles, comporte les mêmes destructions, le même fond nihiliste qui apparaît avec évidence dans l’univers marxiste et communiste, bien que sous des formes et à des degrés différents. Nous ne nous attarderons pas sur ce point, ayant développé dans un autre ouvrage (Rivolta contro il mondo moderno), une conception d'ensemble du cours de l'histoire, de nature à écarter toute illusion quant au sens dernier de l'issue de cette lutte pour le contrôle du monde. Le problème des valeurs n'entrant donc pas enligne de compte, l'homme différencié aura, tout au plus, à résoudre ici un problème d'ordre pratique. Cette petite marge de liberté matérielle que le monde de la démocratie accorde encore, dans quelques activités extérieures, à qui ne se laisse pas conditionner intérieurement par elles, disparaîtrait certainement sous un régime communiste. C'est simplement de ce point de vue que l'on peut prendre position contre le système soviétique et communiste, pour des raisons que l'on pourrait presque qualifier d'élémentairement physiques, et non, certes, parce que l'on croit que le système adverse s'inspire de quelque idée d'un caractère plus élevé.
Il faut le rappeler, d'autre part, que l'homme dont nous nous occupons n'ayant aucun intérêt à s'affirmer ni à s'exposer dans la vie extérieure d'aujourd'hui, sa vie profonde restant invisible et insaisissable, le système communiste n'aurait pas pour lui la signification dramatique qu'elle aurait pour tout autre, et que même dans ce système un « front des catacombes » pourrait bien exister. Dans la lutte actuelle pour l'hégémonie mondiale, s'orienter dans un sens ou dans l'autre n'est pas un problème spirituel : c'est un choix banal qui est affaire de goût ou de tempérament.
La situation générale reste en tout cas, celle que Nietzsche avait déjà définie en ces termes : « La lutte pour la suprématie dans des conditions dénuées de toute valeur : cette civilisation des grandes cités, des journaux, de la fièvre, de l' « inutilité ». » Tel est le cadre qui justifie l'impératif intérieur de l' « apoliteia » pour défendre le mode d'être et la dignité de celui qui se sent appartenir à une humanité différente et ne voit que le désert autour de lui.

Julius Evola ─ Chevaucher le Tigre (1961)
Chapitre VI : La dissolution du domaine social
25. Etats et partis. « L’apoliteia. »
Édition Guy Trédaniel, 1982, p. 212-218.