Reprenons, si vous voulez bien, ces quelques phrases extraites de L’Ombre de Venise : « Il y eut des paysages où les âmes reconnurent d’autres cieux. Ces âmes sont inscrites dans les paysages. Elles y demeurent en signes et en sceaux que les regards attentifs reconnaissent et savent déchiffrer ».
Quelles sont les sources de cette connaissance et de ce savoir que possède le regard attentif ? N’est-ce pas là, dans le processus de dessillement et d’illumination du regard, que l’œuvre d’art a un rôle initiatique et épiphanique ?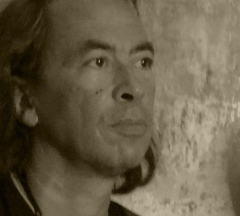 Le regard attentif opère à une subversion du temps. À cet égard, et comme toujours, l’étymologie est bonne conseillère qui nous dit cette attente, cette attention, qui hausse la température du temps, le porte à incandescence et en brûle les écorces mortes... L’attention enflamme, elle s’approche du buisson ardent du sens pour en recevoir les messages. L’attention aiguise, elle délivre… Le drame de notre époque est cette indifférence morose, cette acrimonie à l’égard des êtres et des choses, cette crainte devant la tragédie et la joie qui claquemure les hommes dans leurs résidences sécurisées, au propre comme au figuré. Cette servitude volontaire nous éloigne des épiphanies et des resplendissements de l’âme du monde, de la vérité des paysages et des pays. Une sapience semble s’être perdue, et plus que perdue, refusée. L’odieux du monde moderne est qu’il se veut moderne et nous livre ainsi au kitch effrayant de ses ressassements moroses, de sa muséologie mortuaire.
Le regard attentif opère à une subversion du temps. À cet égard, et comme toujours, l’étymologie est bonne conseillère qui nous dit cette attente, cette attention, qui hausse la température du temps, le porte à incandescence et en brûle les écorces mortes... L’attention enflamme, elle s’approche du buisson ardent du sens pour en recevoir les messages. L’attention aiguise, elle délivre… Le drame de notre époque est cette indifférence morose, cette acrimonie à l’égard des êtres et des choses, cette crainte devant la tragédie et la joie qui claquemure les hommes dans leurs résidences sécurisées, au propre comme au figuré. Cette servitude volontaire nous éloigne des épiphanies et des resplendissements de l’âme du monde, de la vérité des paysages et des pays. Une sapience semble s’être perdue, et plus que perdue, refusée. L’odieux du monde moderne est qu’il se veut moderne et nous livre ainsi au kitch effrayant de ses ressassements moroses, de sa muséologie mortuaire.
La chance nous demeure, cependant, et nous serions coupables de ne pas la saisir, de refuser ce refus, de passer à travers le nihilisme et de retrouver la source vive. Certaines œuvres sont les témoins de ce passage, les ambassadrices d’un monde en « gradations infinies », ─ qui n’est autre que le réel que les Modernes, « ces hallucinés de l’arrière-monde » comme disait Nietzsche, s’efforcent de fuir par tous les moyens. Si l’on considère que la métaphysique n’est pas la négation du monde physique, de même que la surnature n’est pas séparée de la nature, mais sa fine pointe, sa part la plus impondérable et la plus ardente, on pourrait évoquer ici l’art métaphysique, dans la perspective ouverte par des auteurs tels que Henry Corbin, avec sa théorie du « monde imaginal » ou par Ananda K. Coomaraswamy.
L’expression « art métaphysique » recouvre, il est vrai, à moins d’en préciser rigoureusement le sens, un nombre indéfini de réalités qui sont, pour ainsi dire, laissées à la discrétion de l’usager. La plus connue, dans l’art moderne, concerne la peinture de Chirico, encore que l’acception du mot « métaphysique », ici presque synonyme de « surréaliste », y soit des plus vagues. Hors d’une définition philosophique précise (et la définition précise recèle le danger d’être réductrice), tout art, ou aucun, peut être dit « métaphysique ». Tout art, au sens où l’Art vient toujours après la nature, comme la Métaphysique d’Aristote vient après sa Physique. Ou aucun, dans la mesure où l’art suppose, pour exister, pour advenir à notre entendement, un support matériel. La peinture, la sculpture, la musique viennent après la nature, la physis au sens grec, mais elles lui empruntent indubitablement ses manifestations que sont la couleur, la pierre ou le bois, la vibration de l’air… Distinguer un art métaphysique, en tant que manifestation du sacré, d’un art qui ne le serait point exige donc que nous prenions appui sur un autre ordre de réalité que celui de la manifestation, que nous supposions que non seulement l’art mais que la nature elle-même s’ordonnent à une autre réalité, un monde supra-sensible, exactement métaphysique. Si nous ne supposons pas, en dehors de la dimension de l’ampleur de la réalité, une dimension de l’exaltation, de la verticalité, une hiérarchie des états multiples de l’être dont la nature et l’œuvre d’art ne sont, dans l’ordre de la manifestation, que des possibilités parmi une infinité d’autres, nous ne pouvons donner à l’expression « art métaphysique » ou « art sacré » qu’un sens incertain. Une autre tentation serait d’identifier l’art métaphysique à l’art religieux ; il faudrait alors consentir à honorer du mot de métaphysique toutes les œuvres à vocation ou à motifs religieux, y compris les pires saint-sulpiceries ; il faudrait, par surcroît, consentir à nommer « métaphysiques » ou « épiphaniques » toutes les œuvres allégoriques, y compris celles qui se rapportent à des représentations laïques ou idéologiques. L’art religieux peut être métaphysique, et il s’en faut de beaucoup qu’il le soit toujours, tout autant que l’art métaphysique peut, en certaines circonstances, échapper au religieux, à tout le moins dans sa définition communautaire, administrative et dogmatique.
Lorsque Caspar David Friedrich peint un paysage de forêt ou de glace, lorsqu'il nous introduit dans la clarté indécise de l'aube ou du crépuscule, lorsqu'il évoque l'hivers neigeux ou l'automne mordoré, sa peinture est épiphanique non par ce qu'elle représente mais par la manière, le poien, dont le peintre se représente la nature, perçue alors comme une émanation ou un symbole d'une réalité supérieure, hors d'atteinte et pourtant transparue dans le réel, offerte et dérobée au même instant. Intercesseur entre le visible et l'invisible, entre la puissance tue, perdue dans son abîme de silence, et le pouvoir expressif, le vibrato des lignes et des couleurs, entre la nuit et le jour, le peintre semble aux aguets d'une présence mystérieuse, angélique, qui donne aux apparences la profondeur de la vérité. Le symbole, au contraire de l'allégorie, n'est pas un mécanisme dont on use à volonté, mais une grâce. Il n'est pas ce concret qui se résout dans une abstraction, cette expression imagée destinée à se réduire en mots d'ordre mais le pont, l'Écharpe d'Iris, l'échelle du vent... L'art métaphysique se laisse ainsi reconnaître par une légèreté et un éclairage propre, une apesanteur et une luminosité qui n'appartient qu'à lui (et dont il peut être l'hôte par inadvertance, à l'insu même de l'artiste) et que l'on ne saurait imiter ni reproduire à volonté. Il y a dans l'oeuvre d'art attentive à son dessein, comme dans l'expérience alchimique, un principe de non-reproductibilité où entre en jeu un ensemble de relations, tant sur le monde de l'ampleur que sur celui de l'exaltation, qui échappent à l'évaluation et à la volonté humaine. Point d'art sans expérience métaphysique, point de figuration du monde imaginal sans une ascension nocturne, un voyage dans le Huitième Climat ! Le caractère traditionnel de l'art n'ôte rien au caractère unique, à chaque fois, de celui qui l'exerce, reflet de l'unification qui rend possible toute présence comme toute chose représentée. Seuls d'infimes détails distinguent souvent, dans une époque et une aire géographique données, un Bouddha sculptés, un mandala d'un autre mandala, une icône d'une autre icône, mais ces infimes nuances sont aussi importantes, offertes à notre attention, que l'invisible vérité qui s'empare d'elles. C'est par ces nuances, ces variations, que le sacré transparaît, que se laisse deviner la ferveur du geste de celui qui fut en oraison à l'intérieur de son geste. Telle est la légèreté des œuvres de n'être semblables à aucune de celles qui leur sont si proches et qu'un regard superficiel confondrait avec elles. De cette légèreté divine, la lumière ici-bas est la messagère. Nous avons vu les tableaux de Caspar David Friedrich être emportés par l'Écharpe d'Iris au cœur du réel, il suffit maintenant de laisser retentir en soi, en une perspective inversée, l'éclat silencieux de la lumière de l’icône peinte selon les règles de la Philocalie. Celui qui sait faire du Réel une icône reconnaîtra dans l’icône une condensation de la réalité en tant que beauté, et dans la beauté, « la splendeur du vrai ». La beauté Artistique ne peut être que par ce dont elle témoigne, par ce voile qui la révèle « en vérité », de même que la vérité métaphysique ne saurait se manifester en ce monde qu'en beauté. L'art n'est plus alors tourné sur lui-même, replié dans sa propre considération, dans l'illusion d'une autonomie qui le réduit à n'être qu'un pur formalisme, mais un instrument de connaissance, une gnose qui concerne à la fois le monde intérieur et le monde extérieur. La perspective inversée de l'icône illustre cette intuition.
D’où vient la lumière ? A cette question, l’icône donne sa réponse qui est à la fois picturale et métaphysique, en accord avec la liturgie orthodoxe qui proclame que « Dieu s’est fait homme afin que l’homme se fasse Dieu ». Si nous consentons à l’œuvre d’art en tant qu’instrument de connaissance, non sans inclure dans ce consentement, notre condition humaine et le monde sensible qui nous entoure, eux aussi instruments de connaissance, reflets d’un réel plus haut, d’une procession d’Intelligences (au sens plotinien), issues les unes des autres dans une grandiose dramaturgie (telle que la décrivent, par exemple, les œuvres de Sohravardî ), la moindre des choses est de venir à elle, avec une question essentielle (d’où vient la lumière ?) et de recevoir la réponse qui nous est donnée par l’icône : « de nous-mêmes », ou, ce qui revient au même, du pinceau qui lui donna cette forme singulière de « vie » que la science biologique ne suffit à définir.
Face à une icône, nous ne faisons pas face à la lumière émanée mais nous entrons en elle du même mouvement que celui de la lumière. Cette lumière semble venir de nous ; ce sont nos yeux qui semblent éclairer la scène sacrée ; c’est notre regard qui semble le vecteur des photons, des lucioles d’or, qui dansent dans l’espace intermédiaire où l’invisible devient visible. Ce fulgurant renversement de la perspective profane est l’expérience fondatrice de l’Art métaphysique. L’erreur toutefois serait de s’y arrêter ; de ne point percevoir que notre regard n’est que le regard d’un autre regard, lui même témoin d’un éclair qui traverse de part en part le visible et l’invisible, ainsi que le savait Angélus Silésius : « L’œil par lequel je vois Dieu et l’œil par lequel Dieu me voit sont un seul et même Œil. »
De l'exercice de la sensibilité, Saint-Bonaventure disait « l'univers sensible est une échelle pour monter à Dieu ». Si l'on considère que la modernité relève d'un abandon de cette sensibilité au profit de l'intellect, pourrait-on en déduire que les poètes sont les nouveaux hérétiques ?
Toute poésie est hérésiarque ; elle surgit, comme le disait Gomez Davila, par les brèches, par les anfractuosités. Le règne de la quantité la refuse de toutes ses forces ; et l'on oublie trop que le règne de la quantité n'est rien d'autre que le règne de l'abstraction.
Rien n'est plus abstrait, rien n'est plus éloigné du réel et du sensible, dont le propre est de se nuancer infiniment, de qualités en qualités, que, par exemple, la logique statistique, qui rend les êtres humains interchangeables comme des objets de série. Rien n'est plus abstrait que le monde virtuel. Rien n'est plus abstrait que « l'identité » telle que le conçoivent les modernes, c'est-à-dire d'une façon purement statique et administrative. Les modernes manquent généralement d'humilité : ils trouvent que le monde n'est pas assez bien pour eux. Ces magnificences sensibles à chaque instant offertes, ils les dédaignent. Ils rebutent la beauté donnée. Ni le ciel ni la terre ne trouvent grâce à leurs yeux. Ils préfèrent vivre appareillés de technologie dans leur cauchemar climatisé. Leur émotion dominante est le ressentiment. Ils passent à côté de tout ce qui importe, et s'enragent d'utilités futiles avec la fureur des moralisateurs puritains. Ils poursuivent de leur vindicte efficace toute forme de noblesse et de beauté. On ne saurait même dire qu'ils sont irréligieux ou mécréants : les idéologues les étouffant de croyances, de superstitions ineptes au point que, par contraste, la fréquentation des libertins du dix-huitième siècle paraît, en dépit de leur côté quelque peu sectaire, notablement rafraîchissante... Non, ce n'est pas la croyance qui manque, mais la piété à l'égard de « la simple dignité des êtres et des choses », pour reprendre la formule de Maurras. Le monde moderne, est, si l'on peut dire, d'une religiosité infernale, épuisante et parodique. Tout s'y trouve « grande messe ». La « communication » ravage tout, qui s'est substituée à la communion, ─ qui est avant tout recueillement. Dans une société qui n'est plus seulement l'écorce morte de la civilisation, mais son ennemie, les poètes, ceux qui disent ce qui demeure et ce qui fonde, sont les héritiers, et par cela seul hérésiarques, d'une civilité plus ancienne et plus juvénile, celle qui est inscrite, comme le savait Virgile, sur le bouclier de Vulcain.

Refuser l'ordre du haut, c'est être anarchiste, refuser l'ordre du bas, c'est être fasciste. Le poète est-il condamné à être un anarchiste à la recherche d'un Roi ?
Dès lors que du haut en bas règnent le désordre et la confusion, c'est-à-dire l'irresponsabilité de la « racaille dorée » dont parlait Nietzsche ; dès lors qu'il n'y a plus que des « agents » (de change et changements) d'une « Méga-machine » autiste autant qu'erratique dont le centre est partout et la circonférence nulle part ; dès lors que toute souveraineté est perdue et que la société est devenue non seulement l'écorce morte mais l'ennemie de civilisation, ─ force est de reconnaître que l'anarchisme et le fascisme (qui lui-même dans ses débuts, du côté de Fiume, de d'Annunzio et de Marinetti, était, soit dit en passant, d'inspiration sensiblement libertaire) sont des utopies obsolètes. On y discerne la nostalgie de combats d'hommes à hommes, d'idées à idées, dont hélas, il ne reste rien : les servitudes sont désormais volontaires, les manipulateurs manipulés et le pouvoir, si abstrait que de tenter de le combattre, si j'ose dire, « à l'ancienne », c'est encore lâcher la proie pour l'ombre. Notre temps est celui du totalitarisme désincarné : les exploiteurs sont aussi interchangeables et asservis que ceux qu'ils s’illusionnent d'asservir. La confusion de tout donne ce qu'elle doit donner : l'informe qui est le pire conformisme, étayé par la technique dont l'essence est de rendre toute activité humaine impossible sinon par son entremise. Ce ne sont plus les hommes qui échangent entre eux par l'entremise des machines mais les machines qui communiquent entre elles par l'intermédiaire des hommes. Restent donc, comme superstitions, écorces de cendres, l'esprit bourgeois, l'éternel Monsieur Homais, et les anti-fascistes », qui eussent été les plus vils collabos et le savent, et s'en défendent comme ils peuvent en dénonçant, par arrivisme, quelques intellectuels ou écrivains parfaitement solitaires, non sans poursuivre leur dessein, qui n'est autre que la liquidation de la culture européenne et de la tradition française.
Ce pendant, le constat n'est pessimiste qu'en apparence, car ce triomphe des « amis de la mort », des « arriérés de toutes sortes » pour reprendre la formule de Rimbaud, est un faux triomphe. Ce qui n'est pas ne peut vaincre ce qui est, et moins encore ce qui fut. Le nihilisme finit par se détruire lui-même. Il reviendra à quelques-uns d'inventer une piété nouvelle, un honneur, une sagesse, une beauté... Non dans le conservatisme, la réaction, le rempaillage, mais dans le recommencement. Rimbaud encore : « La raison m'est née. Le monde est bon. Je bénirai la vie. J'aimerai mes pensées. Ce sont plus des promesses d'enfance. Ni l'espoir d'échapper à la vieillesse et à la mort. Dieu fait ma force et je loue Dieu ». C'est au plus noir de l'œuvre-au-noir que survivent dans son éclat l'escarbille dansante de la lumière incréée : « Ainsi j'écartais du ciel l'azur qui est du noir et je vécu étincelle d'or dans la lumière nature ». Moins à la recherche d'un Roi, que d'une royauté, ─ celle des heures, des paysages, des visages et des œuvres, les poètes trouveront, sans même chercher, « les mains amies », celles des Calenders dont parle Gobineau dans Les Pléiades. Et puisque j'en suis à citer Rimbaud : « Oui, l'heure nouvelle est au moins très-sévère (...) Point de cantique : tenir le pas gagné. Dure nuit ! le sang séché fume sur ma face... Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d'hommes ; mais la vision de la justice est le plaisir de Dieu seul ».

Pourrait-on dire que la modernité est une entreprise hystérique d'enlaidissement, et que cette hystérie est la seule réponse qu'elle a trouvée pour oublier qu'un jour le monde fut beau ?
L'enlaidissement, pourrait-on dire, en parodiant une formule fameuse, est « une idée neuve en Europe », et condamnée, comme vous le remarquez fort justement, à une surenchère permanente, hystérique, un volontarisme voué à ravager, souiller, dévaster non seulement la beauté apparente, extérieure, manifestée, mais aussi la beauté intérieure, invisible, la beauté dont on pourrait dire qu'elle est en attente dans les âmes. Le cynisme vulgaire (qui est sans rapport, bien sûr, avec celui de Diogène), la dérision terrorisée, la démystification conformiste, les « rebellocrates » selon la formule de Philippe Muray, pour ne rien dire du sinistre cortège de l'envie, du grief et du ressentiment, sont les engrenages de cette machine de guerre contre la beauté. Ce monde est désastré par la bêtise et l'ennui. Et nous savons, par l'étymologie, que l'ennui est de même racine que la haine, son visage lâche, et que l'objet de la vindicte est invariablement la beauté sous quelque forme qu'elle eût l'audace de se manifester, ne fût-ce que dans la beauté d'un geste.
L'enlaidissement des débuts de la société industrielle, avec ses façades noircies, ses arbres aux feuillages recroquevillés par les miasmes acides, ses ciels jaunis de vapeurs puantes, a laissé la place, dans nos sociétés « avancées » à un enlaidissement purement gratuit et l'on pourrait presque dire décoratif. Dans ce décor, dans cet enfer du décor, chacun va dans le reniement des chances magnifiques qui lui furent données, chacun travaille à l'enlaidissement de sa vie et de celle des autres sous l'autorité des « décorateurs » et autres « architectes d'intérieur », mobilisés par cette haine pure, cet ennui drastique qui ne connaît d'autre trêve que la mort.
Le propre de la beauté est d'appeler la gratitude et la reconnaissance. Toutes les religions et la poésie qui parurent jamais sous les étoiles ne furent rien d'autre dans leur mouvement premier, que l'éloge, la reconnaissance auquel on donnait le beau non de piété... Celle-ci, j'y reviens, étant infiniment plus profonde plus juste, et mieux accordée au réel que ne le furent jamais les croyances. La distinction, entre piété et croyance, que souligne Joseph Joubert, est ici capitale. Croire ou ne pas croire est d'importance secondaire. Être impie est l'offense majeure, le péchê et l'erreur irrémissibles. Et quelles plus ostentatoire implicité que la vengeance contre la beauté offerte ? Toute raison d'être s'y effondre avec toute vérité et toute bonté : voici le règne des « hommes-creux », impuissants à créer et à louer autant qu'après à médire et à détruire... Car la beauté n'est pas seulement apparence elle est aussi apparaître, épiphanie comme vous le disiez justement, et tradition, dans le mouvement même du tradere, rivière scintillante, approbation de ce qui fut et se prolonge dans la fine pointe lumineuse du temps.
L'actuelle idéologie de la repentance ne s'offre pas seulement au ridicule du démenti historique (avec celui de célébrer ses défaites plutôt que ses victoires), elle s'enracine si profondément dans la mentalité moderne qu'à titre individuel les modernes en traitent de leur propre vie comme de celle de leur civilisation. Dépréciateurs du passé, « bougistes » compulsifs car cherchant à fuir le néant qu'ils fabriquent devant eux, ingrats des bonheurs partagés et cruels à ceux qui les aiment ingénument, ils empoisonnent les sources vivespar dépit de voir des esprits plus libres s'y abreuver. après les Ubu, Homais, Tribulat Bonhomet, Alcide Croquant, « bienvenue », comme disent les ordinateurs, aux intarissables apologistes de tout ce qui est laid, difforme, hideux, triste et malvenu : autrement dit bienvenue au monde de la culture subventionnée.
Mais plus encore que la beauté des êtres et des choses, le moderne ignore la beauté du temps. Toute chose, qu'elle lui soit belle ou laide (et le « joli » des décorateurs n'étant, selon l'allégorie du Portrait de Dorien Gray, que le verni de la laideur la plus vermineuse) ne lui apparaît que dans un instantané photographique. Or la beauté du temps est celle qui (retour à l'étymologie) suscite le plus exactement notre attention. C'est à son rendez-vous que vient la beauté en attente de nos âmes, comme la beauté en attente des œuvres vient à la rencontre de notre intelligence... Je songe ici à ce que Heidegger écrivit à propos d'Hölderlin : que son œuvre était « en réserve » dans la langue natale des Allemands. C'est ainsi que la beauté advient ou n'advient pas ; par notre consentement ou notre refus à la reconnaître et à l'aimer, à la rejoindre là où elle s'abrite, à l'honorer dans son secret et dans son évidence. Les plus belles œuvres sont de reconnaissance, ─ terme que l'on peut entendre aussi comme une invitation au voyage, à quelque « mission de reconnaissance »... Pour autant que la beauté, qui n'est pas figée dans une représentation, témoigne d'un voyage antérieur, autant qu'elle annonce un voyage avenir, l'un et l'autre selon la figuration de la rosace, ─ où la ligne revient au centre dont elle surgit.
L'expérience de la beauté, dont les modernes s'acharnent à nous priver, a ceci d'éminemment métaphysique qu'elle nous donne à connaître une plénitude qui n'est pas infinie, et moins encore indéfinie, car au moment où elle paraît rien n'existe en dehors d'elle. Elle se trouve ainsi tout à l'inverse de la religion du moderne qui, dans son culte de l'indéfini, croit sans cesse devoir et pouvoir ajouter dans un syncrétisme de plus en plus monstrueux. La beauté est telle que tout ce qui lui ajoute lui retranche ; et c'est précisément ce point de perfection que l'idéologie de la perfectibilité, du progrès, récuse et veut anéantir : cet équilibre, cette hiérarchie, cette autoritas dont la royauté allège le monde.
D'où, chez les modernes, outre la laideur, la lourdeur, ce côté bête traquée, cette inclination à s'identifier avec un « Moi » qui est la plus misérable des fictions, avec ses susceptibilités, ces regards bornés à ce qui se peut utiliser ou acheter, cette indifférence aux bénédictions et aux grâces. Le moderne est si bien incarcéré dans sa logique utilitaire et commerciale que ce qui ne peut s'acheter est pour lui sans valeur. La vie, la splendeur des jours et des nuits. ainsi, il rebute toute générosité, soit la méprisant comme une forme de naïveté, soit la suspectant d'un calcul second. Repus et en même temps éternel nécessiteux dans cette fuite en avant se trouve pour lui automatiquement dévalorisée et sa haine d'autant s'en accroît contre la beauté des œuvres et des âmes qui se suffisent à elles-mêmes, qui reposent en paix, en ressources infinies, dans leur légitimité.

Quel regard portez-vous sur la sexualité à l'époque moderne, que ce soient pratiques sexuelles ou les relations hommes-femmes ?
L'époque moderne est la moins érotique qui soit, la négation de l'Éros étant corrélative de celle du Logos. Le puritanisme et la pornographie sont l'avers et l'envers de cette négation : deux façons de réduire l'Éros à l'utilitarisme de la production et de la reproduction, de l'enchaîner à la répétition fastidieuse de l'économie, de lui ôter ses enchantements et sa divine gratuité. Quant à l'Hamour, tel que le conçoivent les modernes, qui demeurent subjugués par ce que Montherlant nommait « la morale de midinette », il est cet agrégat de sentimentalité niaise, égocentrique et de bas calculs qui littéralement aplatit au marteau-pilon les vertus rares de l'Éros, de l'Agapé et de la Philia. vertus distinctes mais pouvant se conjuguer de diverses façons charmantes et profondes. Ramassées en un seul concept despotique, ces vertus s'étiolent, étouffées par la volition. alors que libres de s'embrasser ou de s'éloigner les unes des autres, elles rayonnent, elles composent de feux, elles varient, elles chantent. Aussi bien est-ce encore du côté des poètes qu'il faut chercher « la clef de l'amour ». Il y a dans l'Éros quelque chose d'heureusement impersonnel, et peut-être de sacré, comme la rencontre de la lumière et de l'eau, que le subjectivisme forcené des modernes refuse et dont il s'effraie. D'où, sur deux versants, ces incessants « problèmes du couple » que l'on nous ressasse, et cette sexualité hygiénique, vantée dans les magazines. Et puis, comment se défendre parfois de l'idée qu'un frottement de muqueuse et l'échange de quelques liqueurs intimes, pour adorable qu'on soit le moment, n'a peut-être pas toujours l'importance capitale qu'on veut bien lui octroyer ! L'Éros ne mérite ni tant de publicité, ni tant de pathos.
Il y a dans l'Hamour, tel que le conçoivent les modernes, et dans la sexualité, dont ils parlent d'autant plus qu'ils n'en ont qu'un usage mécanique et restreint, une forme de bêtise, largement diffusée par le cinéma et les chansonnettes qui finit par rendre les relations hommes-femmes insignifiantes. Ce pourquoi, il faudrait aller du côté de Dante, de l'ésotérisme (qui est l'érotisme de la pensée), de la magnanimité amoureuse, paradisiaque... Dans ce vaudeville incessant que sont devenus les relations humaines, la triste constante est l'infidélité. La fidélité, on l'oublie trop, c'est la confiance, et celle-ci repose sur une alliance qui se situe bien au-delà du sexe. La question n'est pas tout de savoir qui couche avec qui que d'atteindre à cette profondeur temporelle où quelques êtres se reconnaissent, s'allient et demeurent essentiellement fidèles les uns aux autres par piété envers la providence qui leur donna la chance de se rencontrer.
Le partage des brûlures exquises des sens et de l'intelligence est un art. Et cet art relève d'une civilité apprise et transmise. D'où enfin, que la question que vous posez s'intègre parfaitement aux précédentes, dans une perspective politique. Une société compulsivement marchande engendre des relations humaines hystériques. Une société démocratique, et donc tyrannique, invente l'Hamour et son pathos calculateur de manies moralisatrices. Le sexe étant l'ésotérisme des corps, de même que l'ésotérisme est l'érotisme de l'intelligence, c'est encore La métaphysique du sexe de Julius Evola qui demeure, à mon sens, l'ouvrage magistral sur la question.

À l'apocalypse tumultueuse vous opposez l'apocalypse silencieuse. Pouvez-vous nous en dire davantage ?
L'apocalypse est révélation. Elle n'est pas un surcroît d'agitation à ce tumulte, cette frénésie dans lesquels nous vivons déjà. Elle est un suspens. Sitôt cesse le vacarme, le silence respire... Toute discipline humaine devrait tendre à ce moment où le temps redevient éternité, où se désempierrent les ressources du Logos. La confusion des genre règne en bruitage d'ambiance, si bien qu'une épiphanie de silence, comme une explosion fixe, suffit à nous sortir de la torpeur vacarmeuse, à nous relier au cantique stellaire. Le silence est le salut archangélique de la lumière, sa transparence qui laisse advenir, le voile ôté du resplendissement, le cœur de la théophanie. Dans sa plus haute possibilité, le silence est apocalypse. Il détruit, suprême Béatrice mallarméenne, le vacarme, les superstructures du bruit, les résorbe dans la plénitude de la toute-possibilité. Ce qu'il en est de l'apocalypse se laisse comprendre, comme d'autres réalités théologiques, non pas dans une succession ou une linéarité temporelle, mais en synchronicité, voire en simultanéité. De même que l'enfer, le purgatoire et le paradis de Dante ne sont pas des menaces ou des promesses lointainement situées sur une ligne du temps, mais dès à présent, dans la présence même que nous conquerrons ou que nous abandonnerons à l'informe, de même l'apocalypse est ici et maintenant, dans notre regard même auquel est offert la possibilité de transfigurer ou de défigurer le monde. Nous retrouvons là ce que vous disiez de l'enlaidissement du monde. qui ne transfigure pas défigure.
Hausser sa conscience dans la hauteur apocalyptique de son propre dépassement, tel fut toujours le dessein magnifique des philosophies. Plotin, le visionnaire néoplatonicien, Husserl et matutinale née de son propre dépassement, d'une conscience enfin révélée à elle-même dans sa présence même. Le mystère de la présence que disent les poètes et les métaphysiciens est ainsi, par excellence, un mystère apocalyptique. En certaines secondes de rêve et d'ivresse, l'invisible subjugue le visible pour en révéler les splendeurs. Telle semble être aussi l'intuition de Caroline de Günderole dans ses Fragments apocalyptiques : « Or donc, celui qui a des oreilles, qu'il entende ! Point n'est-ce deux, ni trois, ni mille, ni milliers, mais Un et Tout... Point de corps et esprit séparés, dont l'un serait au temps et l'autre à l'éternité, mais l'Un, voilà, qui s'appartient à soi-même, qui est le temps et l'éternité ensemble... » Je pense également à O.V. de L. Milosz, qui dévoua les dernières années de sa vie au déchiffrement de l'Apocalypse de Saint-Jean et cultivait une prédilection pour les noces subtiles du silence et des chants d'oiseaux.
La « langue des oiseaux » si l'on en croit 'Attar est le Symbole des symboles, véritable orient métaphysique et murmurant de l'herméneutique. Tout art de l'interprétation naît du secret analogique de la langue des oiseaux comme la langue bruissant du peuple léger aux yeux vifs et aux ailes douces, évoque l'Apocalypse rayonnante au cœur de la présence de l'être. La Théologie ne dit rien d'autre lorsqu'elle nous rappelle que Dieu est à la fois l'être et l'Intellect.

Quels facteurs exogènes ont contribué à la chute de la pensée occidentale classique dans le nihilisme et le présentisme ? On peut évidemment s'interroger ici sur les composantes innées de cette pensée qui étaient les plus exposées à la profanation.
Dans une vue-du-monde héroïque l'explication du déclin par des facteurs endogènes prime sur la justification par les facteurs exogènes. autrement dit : si nos ennemis nous vainquent, n'accusons que nous-mêmes. Le déclin commence précisément lorsque nous ne comprenons plus que nous avons des adversaires, des rivaux, des ennemis, et lorsque notre étonnement à en avoir nous incline soudainement à dénoncer leur méchanceté imprévisible ou sournoise. Retour à Héraclite. « La guerre est la mère de toute chose ». La vie est un combat... Le principal facteur endogène du déclin d'un peuple ou d'un individu est de l'oublier. Encore que les individus puissent arguer de la malchance ou n'être vaincus que par leur excès de courage dans un contexte ou la coalition des faibles est de nature à abattre n'importe quel colosse ! Mais pour ce qui est d'une civilisation, elle ne tombe jamais qu'abandonnée par ceux qu'elle protège. Nous périssons par ingratitude, par dédain, par charité profanée. L'Occident classique s'est auto-empoisonné. L'alexipharmaque est dans le ressouvenir, car tout ressouvenir est aussi pressentiment. Les vainqueurs méritent leurs victoires, ─ mais sur quoi, ces victoires ? Le poisson pourrit par la tête. Voyez ces « intellectuels » ennemis de l'intellect, ce monde culturel qui n'a de cesse de liquider toute « logocratie » et pour qui les ennemis sont Platon, Homère et Virgile ! Les voici tout disposés à subir la première tyrannie venue de n'importe où pourvu qu'elle les délivrât d'eux-mêmes, de leur propre tradition, de leur culture européenne et française. Point de complots, point d'ennemis invisibles. Tout est là, dans le manque de cœur, dans la défaillance du courage à continuer à être ce que nous sommes. Ce que l'on nomme le nihilisme, et qui n'est rien d'autre qu'une impuissance à penser le néant, le tragique et la joie. Me revient encore une phrase de T. E. Lawrence : « La force réside dans la profondeur d'action, non dans le front ».

Vous sentez-vous proche de ce courant écologiste désigné par le terme « écosophie » qui place l'homme dans un rapport de co-appartenance ?
N'ayant aucune information sur le courant que vous évoquez, je ne saurais vous en dire, sinon que la « co-appartenance » m'apparaît comme une évidence. Nous avons des yeux parce qu'il y a de la lumière, des poumons parce qu'il y a de l'air. Nous sommes, corps et esprit, des instruments de perception. Le cosmos nous entoure plus étroitement et plus continûment que nos semblables. Nos vérités sont météorologiques. Rien ne nous interdit de comprendre le monde, de l'embrasser puisque nous sommes de même nature que lui. L'écriture elle-même prolonge le geste de la nature, et s'apparente au vol des oiseaux, aux nervures des feuillages, aux fleurs de corail, aux figures du givre sur les vitres. Tout cela fut admirablement dit par les romantiques allemands, Novalis en particulier.

Les grattes-ciel du monde moderne illustrent un gigantisme et une verticalité physique qui n'ont plus pour objets qu'eux-mêmes. Néanmoins ne peut-on voir dans ce dépassement sans transcendance, une nostalgie des hauteurs ? Et si l'on considère que c'est là une entreprise luciférienne, ne peut-on en déduire que Lucifer a gardé en mémoire, très-enfoui, le souvenir de sa première demeure ?
J'en suis d'accord avec vous. Nul, pas même Lucifer, n'échappe à la nostalgie de sa première demeure. Dans un contexte non plus biblique, mais grec, l'opposition des titans et des dieux relève d'un sens analogue. La démesure, l'hybris, précède l'effondrement, et le retour de la mesure divine, des justes rapports et proportions, de cette hiérarchie qui seule est pacificatrice. Si les titans sont du côté de l'indéfini, les dieux appartiennent au monde fini. Enfin, comme une mise en-demeure, nous attendrons l'infini du Paraclet, le « nouveau règne » qu'évoquent Stefan George et Pessoa. Mais celui-ci ne saurait plus se comprendre en terme de politique, mais d'une royauté intérieure. Henry Montaigu : « Advienne qu'advienne, mais résister jusqu'à la dernière limite à l'esclavage de l'esprit. Poésie-pensée. Foudre iconographique de l'intellect divin. Langage-reflet. Ordre primordial. »

Entretiens avec des hommes remarquables, réalisé par Le Cercle Curiosa
Luc-Olivier d'Algange
Édition Alexipharmaque, 2012, p.13-29.
