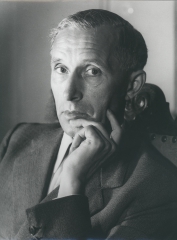 Ces hommes, dont l'existence dans le langage de l'arrière était peinte en quelques mots, comme « camaraderie » ou « fraternité d'armes », n'avaient rien laissé derrière eux de ce qui faisait leur vie en temps de paix. Ils étaient les mêmes, transportés dans un autre pays, transposés dans une autre existence. Ils avaient donc aussi conservé ce sens particulier qui nous permet de percevoir le visage d'autrui, son sourire ou même le son de sa voix dans la nuit, et d'en déduire un rapport entre soi-même et l'autre.
Ces hommes, dont l'existence dans le langage de l'arrière était peinte en quelques mots, comme « camaraderie » ou « fraternité d'armes », n'avaient rien laissé derrière eux de ce qui faisait leur vie en temps de paix. Ils étaient les mêmes, transportés dans un autre pays, transposés dans une autre existence. Ils avaient donc aussi conservé ce sens particulier qui nous permet de percevoir le visage d'autrui, son sourire ou même le son de sa voix dans la nuit, et d'en déduire un rapport entre soi-même et l'autre.
Professeurs et souffleurs de verre qui ensemble montaient la garde, cheminots, mécaniciens et étudiants réunis dans une patrouille, coiffeurs et paysans guettant l'attaque, assis côte à côte dans les galeries, soldats de corvée de transport de matériel, de retranchement ou de soupe, officiers et sous-officiers chuchotant dans les recoins obscurs de la tranchée – tous formaient une grande famille, où les choses n'allaient ni mieux ni plus mal, que dans n'importe quelle famille. Il y avait là de jeunes gars toujours joyeux, qu'on ne pouvait rencontrer sans rire ou sans leur adresser un mot cordial ; des natures de patriarche, la barbe longue et l'œil clair, qui savaient faire régner le respect autour d'eux et trouvaient en toute circonstance le mot juste ; des hommes du peuple robustes, d'un réalisme paisible et toujours prêts à vous aider ; d'insaisissables compères, qui disparaissaient durant les heures de travail dans des boyaux et des abris abandonnés pour fumer ou ronfler à leur aise, mais qui faisaient des miracles lors des repas et régnaient sur les heures de repos par leur verbe haut et l'aplomb de leur humour.
Beaucoup étaient insignifiants, comme des post-scriptum qu'on oubliait de lire, et dont on ne remarquait l'existence qu'à la faveur du coup de feu qui y mettait fin. D'autres encore, vrais enfants du malheur, le visage déplaisant, restaient seuls dans leur coin ; ils faisaient tout sans chic, et personne ne voulait monter la garde en leur compagnie. On les affublait de sobriquets, et s'il fallait un volontaire pour une corvée exceptionnelle, comme transporter des caisses de munitions ou faire du tréfilage, c'était eux tout naturellement que le caporal désignait. Certains savaient tirer d'un ocarina des sons émouvants ou chanter un couplet lors des veillées, d'autres, à partir de cartouchières, d'éclats d'obus ou de blocs de craie, fabriquaient des objets ravissants : tous ceux-là étaient bien vus. Les différents grades étaient séparés par la muraille d'une discipline typique de l'Allemagne du Nord. Sous son emprise les contrastes s'accentuaient, les sentiments s'exacerbaient, mais ils n'éclataient que rarement au grand jour.
Au fond cette communauté d'armes, cette union à la vie à la mort, mettait en pleine lumière le caractère étrangement fugitif et empreint de tristesse des rapports humains. Telle une nation de moucherons ils dansaient leur ballet confus, qu'un coup de vent suffisait à disperser. Bien sûr, qu'une ration inattendue de grog arrive des cuisines, ou que l'atmosphère s'attendrisse dans la tiédeur d'un soir, et tous étaient comme des frères, rappelant même les délaissés dans leur cercle. Que l'un d'entre eux tombe au combat, et tous étaient réunis autour de son corps, échangeant de profonds et sombres regards. Mais quand la mort planait comme un orage sur la tranchée, c'était chacun pour soi ; chacun restait seul dans l'obscurité, assourdi de cris et de détonations, aveuglé par l'éclair des armes, et sans rien au cœur qu'une solitude sans limites.
Et quand plus tard, à midi, ils étaient accroupis sur les bancs de torchis des postes de garde et que des papillons éclatants voletaient des chardons épanouis de la campagne dévastée jusque sur la tranchée, quand les rumeurs du combat pour quelques heures trop brèves se taisaient, quand des rires étouffés répondaient à de timides plaisanteries, souvent un spectre surgissait des galeries dans la lumière ardente, fixait l'un d'entre eux de son regard livide, et lui demandait : « Pourquoi ris-tu ? Pourquoi nettoies-tu ton arme ? À quoi bon t'enfouir dans la terre comme un ver dans le cadavre ? Dès demain peut-être tout sera oublié comme le rêve d'une nuit. » Il était aisé de reconnaître ceux qu'avait visités le spectre. Ils pâlissaient, sombraient dans leurs pensées, et tandis qu'ils montaient la garde leur regard restait fixé dans la même direction que leur arme, droit vers le néant. Quand ils tombaient, il se trouvait toujours un ami pour répéter sur leur tombe l'antique dicton des soldats : « On aurait dit qu'il s'y attendait. Il était tellement changé ces derniers temps. »
Plus d'un aussi disparaissait brusquement ; on retrouvait dans un coin son arme, son havresac et son casque, abandonnés comme la dépouille d'une chrysalide. Des jours ou des semaines s'écoulaient avant que les gendarmes le ramènent, l'ayant arrêté dans une gare ou une taverne. Suivaient le conseil de guerre et le transfert dans un autre régiment. Un de ces silencieux fut découvert un matin par ses camarades mort dans les latrines, baignant dans son sang. Son pied droit était nu, il s'avéra qu'il avait tourné son fusil vers son cœur et appuyé avec les orteils sur la gâchette. C'était juste la veille de la relève, un groupe frissonnant se tenait dans le brouillard autour de la silhouette abattue qui gisait comme un sac abandonné sur le sol gluant, mêlé de boue et de lambeaux de papier. Un goudron d'un brun foncé luisait à travers les interstices creusés par d'innombrables bottes cloutées, le sang s'écoulait comme une huile à l'éclat de rubis. Était-ce le caractère inhabituel de cette mort, dans un monde où mourir était aussi banal que le feu des armes, ou bien le lieu répugnant où elle s'était déroulée : chacun apercevait ce jour-là avec une âpreté particulière l'aura d'absurdité qui nimbe tout cadavre.
Enfin quelqu'un lança une remarque, comme un morceau de liège qu'on jette dans une rivière pour vérifier le courant : « En voilà un qui s'est tué par peur de la mort. Et d'autres se sont tués parce qu'on n'avait pas voulu d'eux comme volontaires. Je n'y comprends rien. » Sturm, mêlé à l'attroupement, pensait au spectre. Lui comprenait très bien que ballotté sans cesse entre la vie et la mort, un homme s'éveillât soudain comme un somnambule entre deux abîmes, et se laissât tomber. Si les étoiles immuables de l'Honneur et de la Patrie ne guidaient pas sa route, ou que son cœur ne fût pas revêtu par l'ardeur belliqueuse comme d'une cuirasse impénétrable, alors tel un mollusque, tel un amas de nerfs à vif, il se traînait sous la pluie de feu et d'acier. Après tout, se dit-il, malheur à ceux qui relâchent leur tension : ici toutes les forces étaient soumises à l'épreuve du feu. Sturm était trop de son temps pour éprouver en de telles occasions de la pitié.
Cependant une autre image s'imposa soudain à son esprit : un assaut de l'ennemi, après un mitraillage furieux. C'était alors les meilleurs, les plus forts, qui bondissaient de leurs abris, et c'est l'élite d'entre eux que broyait en son paroxysme l'ouragan d'acier, tandis que sous terre, dans leurs galeries, les faibles tremblaient et honoraient le dicton : « Plutôt lâche que mort ». Était-ce là la juste récompense de la valeur ? Oui, pour qui savait voir, il y avait ici matière à bien des réflexions singulières. Récemment encore, Sturm avait noté dans son Journal de Tranchée, qu'il tenait à la faveur des instants de repos quand la nuit était paisible :
« Depuis l'invention de la morale et de la poudre à canon, le principe du choix du meilleur n'a cessé de se vider de son sens pour l'individu. On peut suivre précisément l'évolution aboutissant à déléguer peu à peu ce sens à l'organisme de l'État, qui réduit toujours plus brutalement les fonctions de l'individu à celles d'une cellule spécialisée. De nos jours un individu n'a pas de valeur en soi mais par rapport à l'État. Cette éviction systématique de toute une série de valeurs pleines de sens en elles-mêmes permet de produire des hommes incapables de vivre par eux-mêmes. L'État originel, constitué par la somme de valeurs à peu près équivalentes, possédait encore la capacité de régénération des organismes primitifs : on pouvait le dépecer sans porter gravement atteinte à ses composants individuels. Ils trouvaient bientôt moyen de fusionner de nouveau, et reconstituaient leur pôle physique dans la personne du chef, et leur pôle psychique dans celle du prêtre ou du sorcier. Au contraire, toute atteinte grave à l'État moderne menace aussi l'existence des individus, du moins de ceux qui ne tirent pas leur subsistance directement du sol, c'est-à-dire l'écrasante majorité. L'immensité du danger explique la fureur exaspérée, le jusqu'au-boutisme haletant, qui pousse l'une contre l'autre deux puissances ainsi structurées. Ce n'est plus le choc des différentes capacités individuelles, comme au temps des armes blanches, mais de deux organismes géants : capacité de production, niveau technique, industrie chimique, outils de formation, réseau de chemins de fer : voilà les forces qui se font face, invisibles, derrière l'écran des incendies de la bataille de matériel. »
Devant le mort, Sturm se rappela ces pensées. Voilà qu'une fois encore un individu avait élevé une protestation éclatante contre l'esclavagisme de l'État moderne. Mais l'État, telle une idole indifférente, lui passait sur le corps. Cet assujettissement brutal de la vie individuelle à une volonté sans réplique apparaissait ici avec une clarté cruelle. Le combat se déroulait à une échelle grandiose, auprès de quoi le destin d'un individu n'était rien. L'immensité et la mortelle solitude du champ de bataille, la distance où frappaient les armes d'acier et la concentration de tous les mouvements de troupes dans la nuit avaient posé sur les événements comme un masque de titan, impénétrable. On s'élançait vers la mort sans voir où l'on était ; on tombait sans savoir d'où le coup venait. Depuis longtemps le tir précis selon les règles de l'art, le feu direct des canons, et avec eux le charme du duel, avaient dû céder la place au feu massif des mitrailleuses et des concentrations d'artillerie. La décision se réduisait à un simple problème mathématique : celui qui pouvait déverser la plus grande quantité de projectiles sur une surface donnée tenait la victoire. Le combat n'était que le heurt brutal de deux masses, où production et matériel s'affrontaient en une lutte sanglante.
Aussi les combattants, ces techniciens souterrains au service de machines meurtrières, perdaient souvent conscience des semaines durant de la réalité humaine de l'adversaire. Un tourbillon de fumée voilant prématurément le crépuscule, une motte de terre jetée sur un abri en face, par un bras invisible, un appel porté par le vent, c'était tout ce qui s'offrait aux sens en alerte. Il était compréhensible dans ces conditions que la terreur pût triompher d'un homme prisonnier des années durant de cet univers sauvage. C'était au fond le même sentiment d'absurdité qui parfois envahissait les sens accablés devant les quartiers sinistres des villes industrielles, ce sentiment d'oppression de l'âme par la masse. Et de même que les citadins se hâtaient vers le centre pour dissiper parmi les cafés, les miroirs et les lumières les ombres de leurs pensées, dans cet autre monde, par les conversations, les beuveries et d'étranges dévoiements de l'esprit, chacun cherchait à se fuir.

Ernst Jünger ─ Lieutenant Sturm (1923)